On remarque que la première note jouée est la. Bien que la tonalité du
morceau (si elle existe) soit tout à fait discutable, nous
considérerons que la tonalité de départ est la. Les entrées suivantes
sont construites en imitation. La deuxième entrée est jouée à la
mesure ![]() à la quinte supérieure (donc en mi) par les
violons :
à la quinte supérieure (donc en mi) par les
violons :
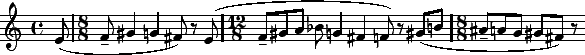
La troisième entrée est jouée à la mesure ![]() par les
violoncelles. Par rapport à la première entrée, elle est jouée à la
quinte inférieure (donc en ré) :
par les
violoncelles. Par rapport à la première entrée, elle est jouée à la
quinte inférieure (donc en ré) :
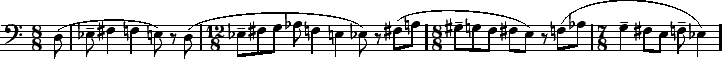
Les instruments à cordes entrent les uns à la suite des autres en
suivant le cycle des quintes jusqu'au mi![]() , comme décrit dans la
figure 6.
, comme décrit dans la
figure 6.
Les numéros se trouvant à l'extérieur du cycle
sont les numéros des mesures où les tonalités se trouvant à
l'intérieur du cycle sont annoncées. On remarque on observant les
numéros que le cycle est parcouru dans les deux sens. Les entrées se
font alternativement en montant et en descendant le cycle des
quintes. Cela jusqu'à la mesure ![]() où les deux extrêmes se
rejoignent. Dans un premier temps, les entrées sont
espacées de
où les deux extrêmes se
rejoignent. Dans un premier temps, les entrées sont
espacées de ![]() mesures, comme indiqué dans la figure
7.
mesures, comme indiqué dans la figure
7.
On observe qu'à partir de la mesure ![]() , il n'y a pas d'entrée pendant
, il n'y a pas d'entrée pendant
![]() mesures. A partir de la mesure
mesures. A partir de la mesure ![]() , ce qui correspond aux entrées
de do et fa#, nous avons deux entrées par mesure. Comme indiqué sur
la figure 8.
, ce qui correspond aux entrées
de do et fa#, nous avons deux entrées par mesure. Comme indiqué sur
la figure 8.
A la mesure ![]() par exemple, les entrées du violon
par exemple, les entrées du violon ![]() et des
contrebasses
et des
contrebasses ![]() et
et ![]() sont décalées d'un temps et se superposent,
formant ainsi un canon :
sont décalées d'un temps et se superposent,
formant ainsi un canon :
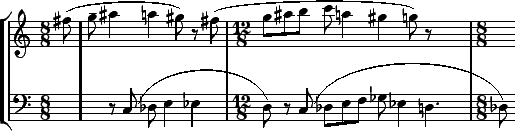
De même à la mesure ![]() , les tonalités do# et fa sont annoncées
respectivement par le violon
, les tonalités do# et fa sont annoncées
respectivement par le violon ![]() et les altos
et les altos ![]() et
et ![]() et ces
entrées sont décalées d'un temps. L'annonce de la tonalité de Si
et ces
entrées sont décalées d'un temps. L'annonce de la tonalité de Si
![]() , à la mesure
, à la mesure ![]() , met fin au canon. Nous restons pendant
, met fin au canon. Nous restons pendant ![]() mesures sans nouvelle entrée, stabilisé sur la tonalité de si
mesures sans nouvelle entrée, stabilisé sur la tonalité de si![]() .
.
Le cycle des quintes est complété à la mesure ![]() : les violons
: les violons ![]() et
et ![]() annoncent la tonalité de mi
annoncent la tonalité de mi![]() , et un temps après les
violoncelles
, et un temps après les
violoncelles ![]() et
et ![]() ainsi que les contrebasses annoncent la
tonalité de sol#.
ainsi que les contrebasses annoncent la
tonalité de sol#.
Nous pouvons déjà proposer un plan en utilisant les positions des entrées comme critère.
| mesure | partie | entrées |
|
|
exposition | la (mesure |
|
|
divertissement | aucune |
|
|
canon | fa# et do (mesure |
|
|
pédale si |
Si |
|
|
strette | mi |
A partir de la mesure ![]() , le cycle des quintes est parcouru du mi
, le cycle des quintes est parcouru du mi![]() vers le la. Les tonalités sont de nouveau annoncées, mais cette
fois-ci dans l'ordre inverse comme le précise la figure
9.
vers le la. Les tonalités sont de nouveau annoncées, mais cette
fois-ci dans l'ordre inverse comme le précise la figure
9.
A partir de ce moment, toutes les entrées se font en mouvement contraire. Si on observe le thème de départ (en la) en mouvement contraire, on a
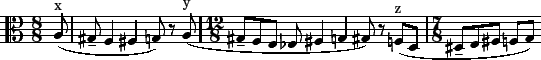
On observe, aussi bien au niveau des annonces des tonalités qu'au
niveau des mouvements mélodiques un effet de symétrie. En toute
subjectivité, l'effet obtenu est comparable à celui que l'obtient en
déformant une surface réfléchissante qui, à partir d'un certain niveau
de concavité (par exemple un rétroviseur posé du mauvais coté...),
se met à refléter le monde à l'envers (un effet similaire est obtenu
avec les lentilles des objectifs).
Pour revenir à des aspects qui mettront plus aisément les lecteurs en
accord avec ma vision des choses. La première annonce est faite en
mi![]() à la mesure
à la mesure ![]() (violons
(violons ![]() et
et ![]() , violoncelles
, violoncelles ![]() et
et ![]() ,
contrebasses), où seule la tête du thème (
,
contrebasses), où seule la tête du thème (![]() ) est exposée :
) est exposée :
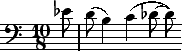
A la mesure ![]() , les mêmes pupitres jouent la partie
, les mêmes pupitres jouent la partie ![]() du thème
transposé en la
du thème
transposé en la![]() :
:
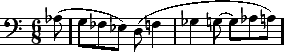
Ce découpage du thème est achevé à la mesure ![]() , où les violoncelles
et les contrebasses annoncent la partie
, où les violoncelles
et les contrebasses annoncent la partie ![]() du thème en ré
du thème en ré![]() :
:
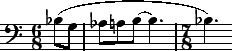
La figure 10 nous montre comment les trois
tonalités mi![]() , la
, la![]() et ré
et ré![]() sont utilisées pour ré-exposer le
thème en rapprochant les entrées (toutes les
sont utilisées pour ré-exposer le
thème en rapprochant les entrées (toutes les ![]() mesures). Le thème ne
s'expose qu'une fois, mais par fragments, provocant un effet de chute
libre. Cette instabilité est renforcé par le fait que thème est
poursuivi une quinte plus bas à chaque fois qu'il est repris.
mesures). Le thème ne
s'expose qu'une fois, mais par fragments, provocant un effet de chute
libre. Cette instabilité est renforcé par le fait que thème est
poursuivi une quinte plus bas à chaque fois qu'il est repris.
Pendant ce temps, les violons ![]() et
et ![]() , ainsi que les altos
remontent le cycle des quintes dans l'autre sens et annonçant les
tonalités rencontrées en ne jouant qu'une seule note de chacune. On
observe ci-dessous les violons
, ainsi que les altos
remontent le cycle des quintes dans l'autre sens et annonçant les
tonalités rencontrées en ne jouant qu'une seule note de chacune. On
observe ci-dessous les violons ![]() et
et ![]() à partir de la mesure
à partir de la mesure ![]() :
:
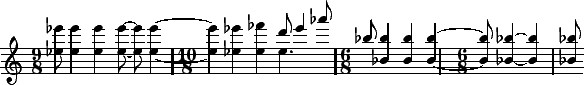
Dans la lignée de l'effet décrit plus haut, trois tonalités sont
annoncées en deux mesures, les violons descendant d'une quarte à
chaque nouvelle annonce accentuent l'effet de chute libre. Les mesures à
partir de ![]() sont consacrées aux annonces de do et fa# en
strette. De façon analogue au canon observé au début du mouvement, on
observe l'annonce des tonalités de sol et si(mesure
sont consacrées aux annonces de do et fa# en
strette. De façon analogue au canon observé au début du mouvement, on
observe l'annonce des tonalités de sol et si(mesure ![]() ), puis ré et
mi (mesure
), puis ré et
mi (mesure ![]() ). Le cycle des quintes est refermé à la mesure
). Le cycle des quintes est refermé à la mesure ![]() par
l'annonce simultanée du thème (violons
par
l'annonce simultanée du thème (violons ![]() ) et de son reflet (violons
) et de son reflet (violons ![]() ) :
) :
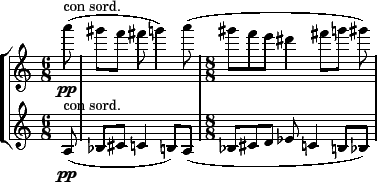
La partie ![]() du thème est, à la mesure
du thème est, à la mesure ![]() , jouée en strette en
alternance avec son reflet. Le mouvement est clôt par deux entrées
simultanées de
, jouée en strette en
alternance avec son reflet. Le mouvement est clôt par deux entrées
simultanées de ![]() (violons
(violons ![]() ) et de son reflet (violons
) et de son reflet (violons ![]() ) joués
en augmentation, et se terminant sur un la joué à l'unisson. Ces
considérations nous amènent à proposer un découpage du mouvement à
partir de la mesure
) joués
en augmentation, et se terminant sur un la joué à l'unisson. Ces
considérations nous amènent à proposer un découpage du mouvement à
partir de la mesure ![]() :
:
| mesure | partie | entrées |
|
|
exposition du thème inversé | mi |
|
|
strette | do et fa# (mesure |
|
|
canon | sol et si(mesure |
|
|
pédale mi |
la et son reflet superposés(mesure |
|
|
strette | la et son reflet alternés (mesure |
|
|
coda | la et son reflet superposés (mesure |